|
|
| 22 : 04 : 13 |

FRANCE BOUGE ! |
Des textes, des appels divers et sans effet, vous en avez vu passer...
Pourtant, est-il possible de supporter encore l'ambiance délétère et autodestructrice qui s'est installée en France ?
Soutenez ce texte (here@see-socioecolo.com) et faites-le circuler, comme je le fais. Il insiste sur 6 axes d'actions prioritaires pour sortir du marasme actuel en redonnant des objectifs communs avec une lisibilité stratégique. Notons que parallèlement le malaise profond touche beaucoup de peuples engagés dans le mouvement SUBITO ! (voir l'article à ce sujet sur www.globalmagazine.info), c'est-à-dire qui n'espèrent plus rien des super-structures et des Etats dépassés ou corrompus mais s'organisent de façon alternative à la base en réseaux
France bouge !
Nous ne supportons plus le climat délétère qui s’est
installé en France. La morosité règne en effet partout dans un esprit de
dépréciation idiot et nocif. Ce pays a pourtant des atouts mais il se comporte
de façon bipolaire comme un grand déprimé : des cocoricos hors de propos
ou, au contraire, la morne résignation du pré-suicidé.
Il est temps d’ouvrir des perspectives grâce à une
vision claire de la situation et du futur. L’actuel Président de la République
a axé sa campagne électorale sur le changement et la jeunesse. Alors, parlons
changement et donnons des perspectives à la jeunesse. Balayant la petite
tambouille comptable qui occupe les écrans, parlons orientations stratégiques :
- La France est à la fois un grand et un petit pays. Elle est un grand pays par son histoire et le rôle
de ses intellectuels dans une conception universaliste de la condition humaine.
Elle est un grand pays par sa culture, son tourisme et certains aspects de son
économie, ainsi que par la pratique de sa langue au-delà de ses frontières.
Elle est un petit pays par l’étendue limitée de son territoire et de ses
ressources. Elle dépend de l’Europe et s’inscrit sur une planète multipolaire
interdépendante. Elle n’est plus le lieu central des arts et des idées. Voilà.
Mais cela empêche-t-il d’inventer ? De proposer, avec d’autres, des
solutions d’évolutions planétaires ?
- Le repli sur soi est de toute façon devenu impossible
à l’ère d’Internet, quand la défense du local, elle, devient indispensable. Même les partisans du Front national croient-ils
vraiment à la fermeture des frontières ou voient-ils leur attitude comme un
baroud d’honneur pour défendre une vision du pays héritée du nationalisme
version XIXe siècle ? Notre réalité est stratifiée entre le local, le
régional, le continental et le terrestre. Il importe à cet égard de simplifier
enfin dans l’hexagone les niveaux de décision. Surtout, avec ce nouveau
contexte local-global, l’urgence réside dans la revivification de la démocratie
du plus proche : consulter régulièrement les citoyens, soutenir les
initiatives de terrain, laisser émerger les propositions. Cela se conçoit
définitivement dans une perspective rétrofuturo, c’est-à-dire de choix entre
des traditions que l’on veut perpétuer et là où la population souhaite innover.
Dans ce cadre, la conception de l’économie s’ouvre, en prenant en compte tout
ce qui fait le vivre-en-commun, économie de la gratuité, de l’échange,
micro-marchés, coopératives et mutualisme, pratiques aidées publiques-privées,
protection des productions locales…
- La crise politique et morale actuelle ne saurait se
résoudre ni dans un « tous pourris », ni dans des réformes de façade.
Disons-le, personne n’a intérêt à
l’écroulement du pouvoir socialiste malgré son inertie coupable ne donnant aucune
perspective réelle hors les restrictions budgétaires. Personne, ni la droite,
ni la gauche, ni donc surtout le pays. Pourtant, la coupure de l’oligarchie
avec l’immense majorité de la population est grave. Les notables se perpétuent
en meute, volant un véritable choix démocratique. Nous avons donc
majoritairement à craindre des désordres et des solutions radicales
liberticides. La démocratie se reconstruit d’abord par la moralisation, la mise
au jour des patrimoines (sans chasse aux sorcières) et surtout l’arrêt des
possibilités de détournements d’argent, la justice fiscale, l’impossibilité des
collusions d’intérêt, la lutte contre l’opacité et des lobbies identifiés, le
bannissement des cumuls délétères (ou des postes à vie). L’usage du référendum
local et national doit être revivifié, non comme une forme de plébiscite mais
comme moyen d’obtenir sur certains points des arbitrages réguliers du peuple.
Parallèlement, il est temps de diversifier l’origine des représentants à tous
niveaux et de placer la mixité sociale comme un impératif premier.
- Cessons de stigmatiser d’un côté un Etat
bureaucratique et inefficace, de l’autre des entreprises d’exploitation
capitalistique. Réformons. L’Etat n’a
de sens que s’il est efficace. Au temps d’Internet, il doit repenser son
organisation et ses missions en limitant la part des administrations centrales
pour valoriser celles et ceux qui oeuvrent en contact avec le public :
décongestionnons et décentralisons l’Etat, clarifions le contenu de ses
missions. Du côté des entreprises, la question n’est plus ni celle du profit ni
celle du marché, mais celle de la répartition du profit et de l’usage du
marché. Les entreprises apportent de l’innovation qu’il faut absolument
encourager (notamment tout ce tissu si précieux des petites et moyennes
entreprises), comme d’ailleurs l’économie sociale et solidaire. Aux citoyennes
et citoyens de devenir des spectateurs-acteurs et des consommateurs-acteurs.
Alors, nous verrons fleurir des entreprises éthiques par intérêt, éthiques par
rapport aux fournisseurs, éthiques en fonctionnement interne et dans leurs
relations avec les clients.
- Il importe de clairement s’engager vers la durabilité
environnementale. L’électoralisme
hypocrite à court terme a assez duré. Cessons de prendre les ouvriers et les
employés pour des imbéciles en leur faisant croire à la pérennité d’industries polluantes ou de produits
sans avenir. Cessons aussi de penser que la croissance verte va se mettre en
place ipso-facto, mais affirmons la nécessité de tout penser en terme de transition verte. Cela permettra de
réconcilier le monde paysan avec des pratiques durables et de changer le
rapport campagnes-villes. Cela fera comprendre aussi –quand les pollutions, les
catastrophes, la malbouffe ou les dérèglements climatiques excèdent les
frontières en touchant les plus pauvres—que la mise en place d’instances
terrestres de préservation de la planète, comme d’ailleurs de police planétaire
sur des principes moraux communs, est indispensable. Tirons-en les conséquences
chez nous, sachons anticiper. L’écologie expérimentale et évolutive –loin des
oukases ou d’une nouvelle religion—est la seule solution de devenir collectif
qui ne soit pas destructeur. Il ne s’agit pas de muséifier la planète mais de
permettre d’avoir une conception globale d’environnements variés en mutation,
en en tirant les leçons locales.
- Les cultures sont des visions du monde. Il faut faire accepter partout l’idée de la
relativité des points de vue en cessant de propager des conceptions exclusives,
sur le plan religieux, idéologique ou des modes de vie. Nous ne souhaitons ni
une planète uniformisée dans la consommation addictive, ni le morcellement
agressif de communautés en concurrence. Affirmer l’importance des cultures est
pour nous affirmer l’importance de l’éducation qui doit donner des options de
choix à l’être adulte et la tolérance nécessaire de toutes les visions du monde,
à condition qu’elles ne tentent pas de s’imposer dans un espace public devant
rester pluraliste. La diversité est pour nous toujours à défendre.
Sur ces bases, nous souhaitons que notre pays --que nous aimons--, qui a de
formidables atouts, sorte de son gouffre actuel. Nous savons toutes les
initiatives qui se multiplient sur le terrain, dans une conjugaison des
générations, par des personnes refusant de se résigner et continuant à agir
concrètement et à inventer. La paralysie et l’autodestruction doivent donc cesser.
Oui, nous voulons une France qui bouge et regarde vraiment en face notre
planète commune en transformations profondes.
Faites circuler et soutenez en écrivant à : here@see-socioecolo.com
|
| 30 : 03 : 13 |
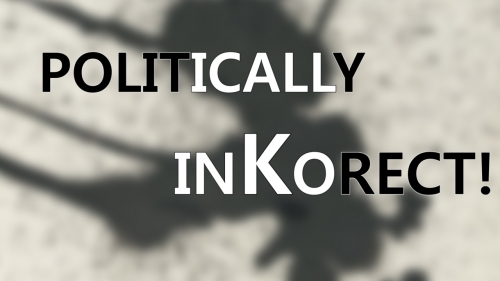
Le monde bouge ! |
Oulalala ! Il s'en passe des choses ! J'avais placé 2013 sous l'angle du réveil et de la générosité. Eh bien, ça bouge dans ce pays déprimé et technocratique qu'est la France.
Nous n'allons de toute façon pas nous laisser chloroformer dans le désespoir.
Bon, alors, qu'est-ce qui bouge ? D'abord, allez sur le plus grand portail d'éducation culturelle francophone : www.decryptimages.net. Vu son succès, il s'ouvre maintenant en version web 2.0 avec une équipe de rédaction augmentée, rajeunie et internationale. Un Réseau décryptimages et une newsletter se mettent en place. L'actualité sera davantage abordée et des ouvertures vers le spectacle vivant et la musique. Avec toujours nos ressources de base exclusives et gratuites en éducation aux images depuis le primaire. Nous allons bouger les conceptions éducatives, en réseau, par la base. La culture des jeunes change profondément, les demandes des éducateurs sont insistantes : agitons-nous en réseaux faisant se croiser les expériences pratiques.
Deuxième date : la Coopcultu s'ouvre sur www.globalmagazine.info. J'ai imaginé cet outil indispensable aujourd'hui avec la complicité de Gilles Luneau et l'équipe de global : signaler et demander de se signaler gratuitement en ligne à tous les acteurs d'initiatives culturelles au sens traditionnel et de l'économie sociale et solidaire, écologique, de la gratuité... Bref, tout ce qui bouge, invente, fait du lien social : cultures de tous, cultures pour tous. Informer, c'est agir. En permettant d'abaisser les barrières des catégories, nous voulons permettre les échanges. Désormais, face aux crises, il nous faut un REVEIL DU LOCAL.
Troisième événement, l'article sur www.see-socioecolo.com (en bas de la home page) : "Hep ! François Hollande, le monde bouge !". Il est temps en effet de stimuler non seulement le Président pour qu'il tombe le masque de sa shadow policy gestionnaire sans perspectives, mais inciter les socialistes et les écologistes à ouvrir d'urgence la boîte à idées. Cet article offre une vision de la planète et du futur claire. Les médias ne peuvent se désoler en effet du manque d'objectifs et d'imagination (rétablir la croissance et réduire le chômage, certes, mais quel type de croissance ? Quelles modalités de travail ? Quelle société ?), tout en relayant toujours les mêmes points de vue éculés depuis 30 ans. Il est temps de bâtir notre environnement socioécologiste dans ce que j'affirme depuis des années : un espace local-global de décisions avec des instances stratifiées ; des choix rétrofuturos, bannissant la notion de progrès et l'idée d'une société idéale, pour intégrer une philosophie de la relativité et la volonté de l'évolution, du mouvement perpétuel. Bougeons nos têtes ! Faîtes circuler !
Quatrième (et non des moindres, car c'est une joie particulière pour moi), voilà enfin la projection en avant-première de mon 7e film long-métrage (voir ci-dessous). Il permet de nous replonger dans ces mouvements du XXe siècle qui voulaient mélanger l'art et la vie en bousculant les normes. Plus que jamais nécessaire, non ? Un antidote à la médiocrité résignée des temps.
Je concluais en 2000 Les Images qui mentent. Histoire du visuel au XXe siècle, publié aux éditions du Seuil, par : Le XXIe siècle sera moral. Prémonitoire ? Il est temps d'ouvrir les yeux, de réinsuffler des idées novatrices dans le débat public (le local-global...) et de donner de l'air avec des personnes neuves, non seulement "propres" mais hors de l'oligarchie visible au pouvoir depuis 30 ans --non représentative de la société-- et de la panne technocratique.
C'est du lourd (des mois ou des années de préparation). Faites circuler ces 4 informations ! Faites savoir !
Première projection du film le mercredi 17 avril à 18h30 à la Bibliothèque nationale de France :
Politically InKorect !
Noël Arnaud
et Dada, Jarry, Picasso, Jorn, Duchamp, Debord, Vian, l'Oulipo...
Un film (1h10) de Laurent Gervereau avec la complicité de Jean-Hugues Berrou et Emmanuel Chirache
Histoire d'un invisible :
voilà le chaînon manquant --et longtemps caché-- entre Dada et les
situationnistes ou Fluxus, en passant par le surréalisme clandestin
pendant la guerre et Cobra. Il s'agit du seul film où cet homme secret
parle de son parcours incroyable, à la fois acteur et passeur des
avant-gardes, ayant côtoyé tous les personnages essentiels cherchant à
changer la vie, à sortir des
frontières de la peinture de chevalet, bousculant la littérature. Entre
jazz, dérives, toiles provocations, fêtes-happenings, rires et absurde,
une existence-oeuvre d'art totale.
Y sont notamment insérés : le manuscrit original de Liberté de
Paul Eluard; un entretien inédit de Constant sur Cobra et les débuts de
l'Internationale situationniste avec New Babylon; des extraits sonores
de la conférence de Guy Debord et Noël Arnaud en 1957.
|
| 25 : 03 : 13 |

Musée du Louvre |
Pour les historiens, voilà le projet que j'avais déposé le 28 janvier 2013 de manière à proposer des pistes de concertation pour orienter l'avenir du musée du Louvre, en postulant à sa direction.
Propositions de pistes pour un projet
d’établissement
Le Louvre,
un musée-monde
pour tous les publics !
Ce texte est une proposition de développement du Musée du Louvre. Il
s’agit de pistes qui mériteront d’être confortées en deux temps : d’abord en
prenant contact avec tous les intervenants liés à l’établissement, ensuite par
une concertation avec la tutelle sur la base d’une liste concrète d’actions pour
un plan d’évolution. Ces propositions sont donc indicatives et seront soumises à ce double dialogue, de manière à
être réalisées dans l’assentiment collectif.
Le constat
Le Musée du Louvre a évolué de façon considérable depuis une dizaine
d’années. Il faut saluer l’action de son directeur, Henri Loyrette, et des
équipes en place. Beaucoup de pratiques nouvelles ont été initiées, jusqu’à
l’ouverture récente du Louvre-Lens.
Fort de ces impulsions, il est temps d’imaginer, dans la concertation,
des pistes pour un musée qui tient une place centrale en France et dans le
cercle des grandes institutions internationales. Ce musée, comme l’a écrit
J.M.G. Le Clézio, est un « musée-monde ». C’est la seule grande
institution encyclopédique française avec son frère scientifique, le Museum
national d’histoire naturelle. Voilà des atouts pour aller au-delà du succès
touristique, en renforçant son rôle
pilote et en l’ouvrant à des pratiques innovantes permettant d’y faire venir de
nouveaux publics. Le but n’est pas de bouleverser une institution qui
fonctionne bien mais de l’orienter dans la concertation vers des développements
nécessaires dans un paysage culturel en profondes transformations.
Fédérer les professionnels
et mieux valoriser les savoirs, renforcer l’éducation culturelle
Le Louvre est un trésor exceptionnel de collections, c’est aussi un trésor
de savoirs et de compétences. Sa chance en est l’aspect encyclopédique. Il
rassemble ainsi des collections précieuses tout en agrégeant des spécialistes
divers. A l’époque où tout s’accumule sur écran sans aucun repère, quel lieu
peut ainsi redonner de la profondeur de champ dans l’espace et dans le
temps ? Ce musée est un vecteur de beauté et un vecteur de connaissances.
Il faut fédérer l’équipe de conservation et valoriser leurs savoirs dans un
projet culturel fondé sur des repères
pour toutes et tous.
C’est au Louvre que toutes les générations et toutes les origines
sociales peuvent se retrouver pour comprendre l’émergence des grandes
civilisations et les systèmes d’influence. C’est au Louvre que l’on peut saisir
la façon dont des conceptions du monde différentes, depuis l’animisme, ont
produit des réalisations esthétiques tellement diverses et tellement
complémentaires. C’est au Louvre que l’aventure singulière décrite par Edouard
Pommier comme l’ « invention de l’art » (apparu dans l’Italie de
la Renaissance) se comprend à la fois dans la fascination des œuvres et dans un
regard éclairé par la connaissance de sa diffusion en Europe puis dans le
monde. C’est au Louvre que nous pouvons croiser histoire des arts, histoire,
histoire des religions et des philosophies avec la géographie.
Le Louvre peut ainsi devenir, davantage qu’aujourd’hui, un lieu de démocratisation et d’éducation
culturelles. Basé sur le socle de son personnel scientifique, en liaison
avec l’Ecole du Louvre et l’INHA, en liaison avec le ministère et d’autres
musées ainsi valorisés sur le territoire (en incluant évidemment les DOMTOM),
il peut développer des programmes pour tous publics (des scolaires au troisième
âge) à la fois sur Internet, sur les chaînes de service public et in situ. Le musée aujourd’hui –je
l’avais écrit dans un ouvrage paru aux éditions du CNRS—est un
« musedia » un musée-média, dans et avec les médias. Son rôle change
et sa fonction sociale va bien au-delà de la simple exposition.
Ainsi, ce musée sera conduit à impulser une visibilité nouvelle sur les
expressions plastiques de toutes époques. Ce faisant, il poursuivra une politique active d’acquisitions et de
donations complémentaires aux fonds existants, tout en jouant sur une ouverture
à diverses formes de la création contemporaine. Lieu pour la recherche, il
la valorise et la fédère en permettant la diffusion la plus large de ses
résultats.
Mon expérience : Ayant conseillé des musées en France et dans
le monde (château de Versailles, Musée d’histoire de France aux Archives
nationales, Musée château des ducs de Bretagne à Nantes, camp du Struthof ou de
Rivesaltes, musée de la mine de Lewarde, musées sud-africains, musées
brésiliens, chinois…) et réfléchi aux évolutions profondes de ces institutions,
je puis aider à donner une nouvelle impulsion au Louvre en fédérant les
équipes. Ayant créé l’histoire générale de la production visuelle humaine (Histoire du visuel) et dirigé le Dictionnaire mondial des images avec 475
spécialistes du monde entier, je puis impulser un plan d’éducation et de
diffusion culturelle. J’ai de plus contribué de longue date aux recherches sur
l’art (et les différentes formes de création) de toutes périodes, aussi bien au
Musée d’histoire contemporaine, comme au Centre Pompidou, à Neuchâtel et au
Musée des Beaux-Arts de Münster ou pour l’année « Utopies et
innovations » 2010 sur 16 villes entre France, Suisse et Allemagne, dont
je fus commissaire général. Ayant travaillé avec de nombreux artistes
contemporains ainsi que de multiples collectionneurs, je puis enfin poursuivre
une politique active de complément des collections et de confrontations
heuristiques des formes de création.
Un musée-monde et non le
monde dans un musée, une passerelle avec toutes les civilisations
Les deux reproches majeurs apportés aux musées sont leur côté mortifère
–un embaumement, le musée contre la vie—et le fait d’être des « bunkers de
pillards ». Cela a repris une certaine actualité quand des institutions
comme le Te Papa Museum en Nouvelle-Zélande ont été créées. Issue de l’ancien
musée colonial de Wellington, cette institution s’est voulue encyclopédique mais
à travers le regard croisé entre la conception européenne et maorie du monde.
Sur beaucoup de continents en effet, la
façon dont les musées occidentaux accumulent des pièces de toutes origines dans
des présentations semblables au nom d’un « Beau universel » choque.
C’est même vu comme une forme de néocolonialisme car –ainsi que le note
l’anthropologue Jacques Maquet—tout ce qui est antérieur à la Renaissance ne
relève pas de l’art (des pierres taillées aux cathédrales), ni non plus ce qui
appartient aux civilisations extra-occidentales. Il s’agit en l’occurrence
d’une « esthétisation de l’utile », alors que l’art suppose de créer
dans le seul but de la délectation esthétique.
Comment alors parer à cette petite bombe politique à retardement ?
En affirmant clairement le Louvre comme
un musée-monde, c’est-à-dire un musée dont le but est d’établir des passerelles
entre les civilisations. Il n’est pas l’accumulation et la mise sur le même
plan de pièces d’époques et de lieux très différents. Il est un moyen de
comprendre et de pénétrer des civilisations variées dans le respect de chacune
en expliquant le rôle spécifique de chaque pièce. C’est un musée-monde pour la
tolérance et la compréhension de l’histoire, pas le monde dans un musée.
Mon expérience : Ayant créé en 1991 l’Association
internationale des musées d’histoire que j’ai dirigée pendant 13 ans, j’ai été
confronté non seulement au management d’une organisation lourde avec des
susceptibilités nationales vives, à la gestion de gros budgets (notamment travers des projets européens comme
EUROCLIO), mais aussi à des types d’institutions très variés. Les musées
d’histoire ont en effet des collections qui vont de l’art à la vie quotidienne.
Ils touchent toutes les civilisations et toutes les époques, ce que nous avons
affirmé lors du dernier congrès que j’ai présidé pour cette organisation avant
de passer volontairement la main (en 2004 au Brésil) : « Comment organiser
un monde multipolaire ? ».
« Traduire l’art »
afin d’ouvrir le musée à des publics nouveaux, faire comprendre le rôle des
femmes comme la diversité des modes de création
Disons-le, nous connaissons une mutation profonde de toutes les
institutions patrimoniales (qui rapprochent d’ailleurs de fait les musées,
bibliothèques, médiathèques…), dans une époque où les publics et leurs attentes
changent profondément. La civilisation de l’écran est commencée. Les musées
scientifiques et les musées d’histoire en ont pris la mesure quand ils se sont
aperçu que leurs publics jeunes et moins jeunes n’avaient pas ou plus les
repères de base pour appréhender les parcours muséographiques. Les musées d’art
savent désormais qu’ils n’attirent pas toute une partie de la société se
considérant comme « étrangère » à cette production artistique, parce
que les formes sont trop éloignées des médias contemporains et les éléments
pour en saisir le sens manquent.
Une peinture religieuse du XVIIe siècle nécessite d’être expliquée
désormais, autant qu’un masque Dogon ou un objet égyptien. La rupture culturelle est profonde. C’est une chance pour les musées
qui sont incités à inventer. J’avais ainsi monté une exposition au château
de Versailles, à l’époque où Jean-Jacques Aillagon le dirigeait, dans la
Galerie des Batailles, intitulée La
Guerre sans dentelles. Née du constat que le public marchait dans cette
galerie sans souvent regarder les grands tableaux, il s’agissait de confronter
la photographie de guerre et la peinture de guerre. Le résultat fut très
heureux, car le public, intrigué, s’est alors penché sur les deux (peinture et
photo). Le film ou la vidéo auraient aussi bien pu atteindre le but assigné, en
faisant comprendre, par un média familier, combien ces peintures étaient
constituées comme une bande dessinée en une image où le regard individuel suit,
dans ces compositions impossibles en photographie, les différentes étapes
visuelles de la narration de l’événement.
Il faut ainsi « traduire » l’art, comme il faut expliquer le
contexte de création des œuvres exposées. Ainsi
les publics comprendront aussi que l’acte créatif, depuis les origines, ne fut
pas seulement masculin mais que les femmes y prirent une grande part, et qu’il
ne fut pas juste destiné aux couches puissantes mais répandu dans les vies
quotidiennes de tous. L’ouverture de la notion d’art à toutes les
civilisations et à différentes formes d’expression (« les arts »),
déjà mise en œuvre dans les parcours du Louvre, permet de mettre en valeur ces
nouveaux modes de compréhension. Il faut parallèlement l’expliquer en inventant
des événements, ouvrir de micros-expos dossiers temporaires qui apportent des
éclairages ponctuels et rompent les longs déroulés d’œuvres et d’objets, tout
en permettant des animations en ligne.
A nouveaux regards, nouveaux publics. C’est en jouant sur la passion
historique des Françaises et des Français, en même temps que des initiatives
neuves et originales (à destination des banlieues, des handicapés, par des
programmes en ligne, des initiatives en partenariat régional…), que le Louvre
deviendra familier à de nouveaux publics. Il a des collections d’exception,
désormais il importe de développer de nouveaux regards sur ces collections. De
plus, en terme scolaire, cela peut en faire un lieu-repère de base fédérateur
pour pénétrer tant l’histoire nationale que la diversité des civilisations.
Mon expérience : Je dirige avec la Ligue de l’Enseignement
le plus important portail culturel francophone : www.decryptimages.net, dont le Louvre
est un des partenaires. Ayant développé de 1978 à 2001 le Musée d’histoire
contemporaine, j’ai pu constater la passion pour les grands sujets d’histoire
(j’ai ainsi monté la première grande exposition sur la guerre d’Algérie en
1992, sur l’histoire de l’immigration, sur la propagande sous Vichy, Images et
Colonies ensuite co-adaptée à Dakar avec mes collègues sénégalais…). Les musées
d’histoire attirent ainsi des couches de la population qui ne vont jamais dans
les musées d’art. Il est temps, comme je l’avais projeté quand j’ai pris la
succession de mon ami Antoine de Baecque à la direction du Musée du
Cinéma-Henri Langlois, de généraliser ces pratiques d’ouverture à des publics
variés.
Développer l’aspect tête de
réseau avec les collectivités locales, utiliser les nouvelles technologies
comme outil de valorisation en temps de gestion rigoureuse, ne pas oublier
l’impératif écologique
L’offre culturelle in situ et
en ligne est considérable, comme jamais elle n’a été. La hausse qualitative
patente partout. Mais la visibilité publique en pâtit. Tant d’initiatives
n’atteignent pas leurs publics potentiels. C’est désolant et constitue une
forme de déperdition d’un argent (généralement public) devenu rare.
La faute ne peut en être imputée aux médias qui ont du mal à vivre et
dont les rubriques sont limitées (presse ou télévision). Il importe alors que
les structures étatiques servent de relais médiatiques, permettent au public de
se repérer, mettent en valeur les initiatives. Cela concerne les DRAC, le Service
des musées de France, la RMN et les grands établissements. Le Louvre apparaît
encore, même si les grands départements collaborent activement avec les musées
de province, trop isolé, ne jouant pas assez son rôle de pilote.
Dans une concertation très large, notamment avec les élus locaux de
l’hexagone et des DOM-TOM et avec les professionnels, un portail Internet
pourrait aider à donner plus de visibilité aux initiatives, même de très
petites institutions, aux collections, à toutes les ressources en ligne. Des
partenariats « Label-Louvre » pourraient se multiplier, et pas
seulement avec des musées de beaux-arts.
Le Louvre est un producteur
d’images et de savoirs en ligne, il peut devenir aussi un portail de
valorisation. Cela n’est pas
une question lourde en termes financiers, alors qu’elle devient indispensable
pour la « visibilité » culturelle au sens large du territoire. Il
doit aider davantage encore aux grandes avancées réalisées notamment par le
site culture.fr. Enfin, le Louvre
doit être exemplaire et innovateur, tête de réseau, concernant l’écologie au musée. Il s’agit d’un
impératif matériel comme d’un impératif culturel.
Mon expérience : Ma vie a été consacrée à la constitution et à
l’animation de réseaux. J’ai fait partie à Paris, en province et à l’étranger,
de nombreux conseils scientifiques. J’ai collaboré avec de nombreuses
institutions, comme en 2012 avec le Centre Pompidou-Metz ou le Musée d’art
moderne de la ville de Paris. J’ai beaucoup circulé, en France dans le cadre
notamment de ma présidence du Conseil français des musées d’histoire et à
l’étranger pour le Réseau des musées de l’Europe. Je préside l’Institut des
Images comme l’Ecology and Sustainable Development Network à l’ICOM-UNESCO
(fondé au Te Papa Museum en Nouvelle-Zélande). Depuis 1999, j’ai créé des
portails sur le Net et ai réalisé 7 films longs-métrages. Je dirige le musée
international sur l’écologie et, en 2012, ai présidé le colloque « Patrimoine de l’écologie et écologie du
patrimoine » avec des représentants de tous les continents.
Travailler avec la tutelle
et « faire image » à l’international, porter le local vers le global
Le Louvre, grâce à son prestige et à toutes ses initiatives déjà
engagées, a de fait un rôle de modèle. Le Louvre n’est pas un musée comme les
autres. Il est le premier musée de France et le plus grand musée généraliste au
monde. Il sert ainsi l’image de la France dans le monde : le Louvre est
une vitrine qui fait image pour la France tant par ses opérations physiques que
par le développement nécessaire de sa production en ligne. Voilà pourquoi sa
direction doit travailler en synergie avec sa tutelle, au service des messages
que le Président de la République et son gouvernement veulent faire passer.
C’est un porte-étendard. C’est un producteur de sens, un producteur de
programmes aussi pour la francophonie et au-delà.
Grâce à cette synergie avec les
tutelles et en répondant à leurs attentes stratégiques, il jouera ce qui est
attendu aujourd’hui de l’Etat et de ses grandes institutions : un rôle de
« passeur » du local au global. Ce musée –nous l’avons dit—peut aider à valoriser en réseau les
initiatives régionales pour leur donner plus de visibilité. Il peut développer
partenariats, labellisations et portail référent en ligne, de manière à sortir
de l’émiettement des ressources. Il peut aussi accompagner la politique
étrangère du pays et sa volonté de valorisations culturelles.
Le Louvre, musée-monde, est un
lieu-passerelle entre les civilisations. Le Louvre n’est pas seulement un musée d’art (d’ailleurs, il conserve
des objets de la vie quotidienne antique ou des arts décoratifs), il est un
grand musée de civilisations. Par une politique d’accords internationaux sur
tous les continents, il peut défendre la vision tolérante et universaliste des
Lumières, en liaison avec le Musée du Quai Branly. Il peut faire comprendre les
richesses locales de nos territoires tout en s’axant sur les systèmes
d’échanges et d’influences entre les civilisations. Son discours, basé sur la
beauté esthétique, peut véhiculer l’idée forte d’une évolution collective des
créations humaines, dans leurs diversités et leurs sensibilités qui font leur
richesse, mais avec des aspirations communes fortes. Ne pas tout mêler comme
cela est réalisé brutalement sur nos écrans, expliquer les différences de sens,
mais aussi les influences, les parallèles. Cette
action a d’autant plus de sens et de nécessité en termes pédagogiques que les
enfants de nos classes sont souvent issus de tous les continents : il leur
faut des repères. Le Louvre peut montrer l’exemple.
Une telle politique culturelle d’établissement s’établit pas à pas,
sans heurt, dans la concertation interne et la valorisation des pôles
d’excellence déjà fortement dégagés. Elle se lance avec l’assentiment de la
tutelle et en synergie avec la ministre de la Culture et son cabinet. A cet
égard, les milieux professionnels français du patrimoine ont beaucoup souffert
du manque de relais auprès des tutelles. La nomination d’une ou d’un
professionnel du patrimoine qui soit référent serait un signe fort pour toute
la profession et le gage d’un travail immédiat avec les personnalités
compétentes internes, les réseaux français et internationaux. Cela permettrait
de tenir le bon équilibre souhaitable entre la coordination interne et es
liaisons externes : une direction qui définit une politique culturelle
après concertation avec la tutelle, une direction qui l’applique en coordonnant
les services administratifs et financiers avec la nécessité de diffusion, de
communication et de commercialisation.
Il ne s’agit pas de bousculer
un établissement comme le Louvre, car tout doit se faire dans la confiance en
un projet commun et dans la concertation, mais de l’accompagner pour des
évolutions nécessaires et profitables à toutes et à tous. Parier sur
l’évolution et l’innovation serait un signe fort pour les professionnels comme
pour l’opinion publique.
Mon expérience : Mon parcours atypique correspond probablement
aux savoirs divers nécessaires aujourd’hui pour faire évoluer un établissement
aussi important et complexe que le Louvre : l’habitude de gérer des
grandes équipes et de les dynamiser dans des projets communs, une longue
connaissance de tous les patrimoines et de leurs réseaux français et étrangers,
le montage de très nombreuses expositions d’art et d’histoire, une utilisation
depuis 1999 des nouvelles technologies et de leurs possibilités confortée par
une pratique personnelle de l’écriture et du cinéma, enfin une réflexion de
fond sur les grandes mutations en cours (Vous
avez dit musées ? Tout savoir sur la crise culturelle, publié aux éditions du CNRS). Cela a alors probablement du sens que le
Louvre m’ait demandé d’ouvrir et de présider en 2007 le colloque des journées
professionnelles : Le musée ça fait du
bien ? ou que France Inter m’ait invité à parler en direct, au moment
de l’ouverture des salles des Arts de l’Islam, des musées du XXIe siècle.
Laurent Gervereau
Janvier 2013
|
| 25 : 02 : 13 |
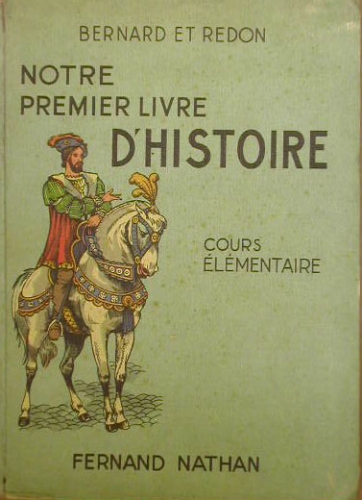
Il faut réveiller l'Histoire |
[Ce texte de fond vient à son heure : l'heure où triomphe le futile et la gestion égoïste à courte vue. La mort de Stéphane Hessel résonne d'autant plus. Quand je l'ai associé à l'exposition sur l'histoire de l'immigration en France en 1998, il était âgé déjà mais ignoré des médias et du grand public. Vif, ouvert, c'était pourtant un vrai plaisir de l'accompagner en devisant. Je fus marqué des années plus tard, lors de l'inauguration de la Cité de l'immigration : anonyme, debout dans le fond près du mur droit, ignoré, caché. Si bien que je suis allé causer avec lui. Un bel esprit pour lequel j'avais du respect, comme pour Jean-Louis Crémieux-Brilhac, que j'apprécie infiniment, ou Michèle Bernstein. Leurs propos vous honorent et vous contraignent à une certaine hauteur de vue : un bonheur que cette culture spontanée, fine et drôle. Ils nous illuminent, même si résister à la médiocrité est sûrement plus ardu que résister à la répression. Au nom de ces personnes, il ne faut rien lâcher de l'exigence, quitte à être sans cesse à rebrousse-temps. Les sourds finiront par entendre (ou leurs enfants).
Au nom de ces personnes, il importe ainsi de persévérer à tenter
de regarder "large", grand angle, malgré la purée de pois ambiante.
Alors, aujourd'hui, nous pourrions probablement considérer le XIXe siècle comme un
temps d'utopies se voulant progressistes (même à travers les errements de
l'industrialisation et du colonialisme) après les révolutions américaines et
françaises. Le XXe siècle, à rebours, peut se lire comme le temps de
l'autodestruction humaine : guerres mondiales, pollutions planétaires, épuisement
des énergies fossiles, bombes atomiques, exterminations, destruction des
cultures, hyper-concentration de la finance, surpopulations, misère généralisée
des consommateurs addictifs... Tâchons donc de faire du XXIe siècle le siècle
de la morale, du choix moral, et, ce faisant, le siècle de la reconstruction planétaire. Soyons des
utopistes du XIXe siècle avec le pragmatisme hérité des catastrophes du XXe siècle. Mêlons toutes les bonnes volontés, car nos nouvelles sociétés seront issues d'initiatives de terrain, comme veut en rassembler la Coopliberterra, ouvertes, de l'économie sociale et solidaire, des B Corporations (B Corps) ou des Colibris et de tant d'autres mouvements : l'emploi et le vivre-en-commun ne peuvent venir de la seule macro-économie mais des micro-actions en réseau par la mobilisation de chacune et chacun : RECONSTRUISONS par nous-mêmes]
[et, c'est un signe, je reçois ce matin --1er mars--, au sujet de l'article ci-dessous, ce mot délicieux envoyé du Collège de France : "Frère Gervereau, Je fais circuler autour de moi. Merci. Amitiés. Daniel Roche"]
La sortie de deux livres récents doit nous alerter sur un basculement
nécessaire en ce qui concerne la science historique, celle que Gérard Noiriel
considérait déjà en 1996 comme en « crise » (en demandant alors le
développement de la « socio-histoire »). En effet, Christophe Charle
d’abord, dans Homo Historicus (commenté
dans ces colonnes par Antoine de Baecque), rassemble des articles où il
stigmatise l’invention d’un « âge d’or supposé » permettant de se
désoler de la perte d’influence du modèle historiographique national. Il y voit
le moyen pour quelques mandarins de verrouiller nostalgiquement un système qui
leur profite et dont ils ne veulent pas comprendre l’obsolescence. Le second
livre est celui d’un mandarin justement, qui fut un des acteurs de cette
déploration (L’Histoire est-elle encore
française ?, 2011), Jean-François Sirinelli. Ce dernier appelle
désormais à Désenclaver l’histoire.
Prenant en compte une « culture-monde » au XXe siècle, il tente d’en
reconsidérer la périodisation.
Voilà des signes, des signes que la science historique doit maintenant
sortir d’égarements et de sujets battus et rebattus. Il existe paradoxalement
toujours une dimension anachronique dans la manière dont les individus, à
chaque époque, se penchent sur le passé : nous nous intéressons à hier
pour des raisons d’aujourd’hui. C’est d’ailleurs à l’historienne et à
l’historien de sans cesse rappeler le contexte pour éviter des distorsions et
des instrumentalisations.
Aujourd’hui, dans notre paysage en complet bouleversement, il importe
donc d’offrir de nouveaux caps aux jeunes professionnels dont les intérêts se
sont considérablement élargis. Pour ce faire, mettons en avant trois chantiers
prioritaires : réaffirmer l’importance du travail historique par rapport
aux multiples dérives de la « mémoire » ; commencer à mettre en
place une « Histoire stratifiée » (« Laminated History »),
comparatiste, du local au planétaire ; prendre en compte la multiplication
exponentielle des documents iconographiques en en faisant des sources comme
d’autres (l’Histoire ne peut se baser seulement sur l’étude de l’écrit) et
l’objet d’une Histoire spécifique du visuel, histoire générale de la production
visuelle humaine (qui englobe l’histoire de l’art ou des arts).
Sortir des errements de la
mémoire
Lorsque Pierre Nora fait paraître en 1984 le premier tome des Lieux de mémoire, cela intervient dans
un temps de basculement de civilisation dont la vogue des écomusées est
l’expression. Les campagnes françaises se sont modifiées dans les années 1970
comme jamais. Les bases de la construction nationale élaborée au XIXe siècle,
et dont Notre premier livre d’histoire
de Bernard et Redon illustré en 1955 par Henri Dimpre est exemplaire (il
servira largement au cours des années 1960), s’effritent. Les luttes politiques
et culturelles contre la société de consommation accréditent alors ce
basculement du milieu des années 1960 (1967 probablement d‘ailleurs) mis en
avant par Jean-François Sirinelli.
Les lieux de mémoire furent ainsi
une sorte d’inventaire des signes de l’identité nationale dans le temps de son
délitement. Reconnaissons au directeur de l’entreprise –Pierre Nora—d’avoir
saisi les dangers de l’exercice dès son introduction générale. Il séparait bien
conceptuellement l’histoire, « reconstruction problématique du
passé », et la mémoire, qui est un « absolu », un absolu pouvant
inclure des erreurs factuelles. La grande dérive est venue du succès de la
notion. En effet, des groupes, souvent communautaristes, ont sauté sur
l’occasion pour réclamer un « devoir de mémoire » dans des mémoires
victimaires concurrentielles (Shoah contre esclavage, par exemple). Les
politiques s’en sont emparés pour confondre commémoration et histoire, fondant
des institutions commémoratives au futur précaire, au lieu de cérémonies et de
monuments du souvenir.
Dès la fondation de l’Association internationale des musées d’histoire en
1991, j’ai moi-même alerté sur ces dangers en insistant sur la nécessité de
créer de vrais musées d’histoire en liaison avec les scientifiques. La mémoire
peut y être racontée ou collectée, à condition qu’elle vienne en complément de
parcours historiques solides. Ce fut le cas au Deutsches Historisches Museum de
Berlin comme au Musée-Château des ducs de Bretagne à Nantes. Et le retour à
l’histoire s’est manifesté ensuite à Saint-Quentin-en-Yvelines, passé d’écomusée
à « Musée d’histoire de la ville ». Tout aussi significatif, à Caen,
le Mémorial est désormais : une « Cité de l’histoire ». Nous
passons ainsi du devoir de mémoire au
besoin d’histoire, quand les repères
de base manquent.
Mais il y eut de nombreuses dérives dangereuses. Elles se cristallisèrent
autour des fameuses lois mémorielles, aboutissant à la création de
l’association Liberté pour l’Histoire, fondée autour de René Rémond en 2005.
Ironie des temps, Pierre Nora la dirige désormais, ce qui est un signe. Les
politiques se sont rendu compte que la mémoire ouvrait la porte au
communautarisme et à la fracture dangereuse du vivre-en-commun dans notre pays.
Les historiens, de leur côté, se sont émus d’une histoire instrumentalisée et
orientée dans ses buts et dans ses recherches.
Pour avoir réalisé des manifestations publiques pionnières sur la
propagande sous Vichy ou la guerre d’Algérie, l’histoire de l’immigration en
France ou l’affaire Dreyfus, je puis témoigner que seul le travail historique
problématisé collectif permet d’aborder et de présenter au grand public des
éclairages sur des questions délicates. Il est donc important aujourd’hui
d’inciter la jeune génération à s’inscrire dans les voies exigeantes de la
recherche historique, même s’il pourrait être tentant d’accompagner des
entreprises mémorielles ou de céder à la vague commerciale de
l’histoire-anecdote et de l’histoire-célébration des puissants (posant
d’ailleurs la question de la fonction du service public télévisé).
Voilà pour la méthode. Mais faire travail historique sur quoi ?
Quelles sont les priorités ?
Le local-global, dimension
permanente d’une « histoire stratifiée »
Pour comprendre nos nécessités actuelles, il faut se promener dans les
classes du primaire, ou des collèges et lycées. Nous avons partout des enfants
issus de tous les continents. Il n’est plus possible donc de juste leur
expliquer l‘histoire de la construction nationale, ni à leurs camarades
d’ailleurs au temps de la mondialisation des échanges.
Pour ce faire, d’aucuns pourraient vouloir « noyer » les
histoires nationales dans une histoire mondiale. Ce serait une erreur. Notre
compréhension du présent et du passé suppose désormais d’en saisir l’aspect
« stratifié » : du local au national, du national au
continental, du continental au planétaire. Il s’agit donc d’une
histoire-territoire qui, partant de la constatation des frontières du moment,
embrasse le temps long (depuis la préhistoire) de ce territoire en l’inscrivant
aussi dans le passé de ses composantes et d’échanges et d’influences qui
excèdent ce territoire.
il est très important pour ce faire d’abord de réveiller l’histoire
locale. Elle a un sens fort à Nice, à Guéret, à Quimper, Strasbourg ou
Pointe-à-Pitre. Et ce sont des histoires locales et régionales fortes, tellement
différentes. Chaque enfant doit savoir où il habite, le passé de là où il
réside. Il habite sur un territoire avec un peuplement humain depuis la
préhistoire. Cela nous contraint alors à expliquer aussi l’histoire
continentale et l’histoire terrestre (dite « globale ») depuis
l’apparition d’homo sapiens (et même avant). Ce faisant, les circulations
seront mises en avant, comme les influences : il n’existe aucune
civilisation « pure ». Et même les religions ont une histoire.
La mondialisation est en fait constitutive de l’humanité. C’est ce que
nous apprennent les préhistoriens, des chercheurs comme Serge Gruzinski pour la
Renaissance, ou des cas particuliers (trésor de Begram en Afghanistan,
rassemblant des pièces grecques antiques, chinoises, de la vallée de l’Indus ;
tombes de Mapungubwé au nord de l’Afrique du Sud, avec objets africains, de
Pondichéry ou de Chine (dynastie des Song)). Voilà pourquoi tous les enfants
doivent disposer des rudiments d’une histoire planétaire avec tous les
continents, qui sera aussi un moyen de comprendre la diversité des
civilisations et de sortir d’une vision coloniale européo-centrée.
Mais bien-sûr, dans cette histoire stratifiée comparatiste, il est
essentiel de comprendre la construction de l’histoire nationale, ses éléments
culturels (dont la langue), et, pour le cas de la France, ce que furent et ce
que sont ses messages universalistes. Cette histoire n’est ni une histoire des
dirigeants, ni une histoire des peuples. Elle aborde tous les aspects. Elle
n’est ni laudative ni de contrition, elle étudie les faits et en montre les
diverses facettes. Bref, elle essaie de rester scientifique, de prendre en compte
les dernières remises en question, les derniers états de la recherche. Enfin,
même si elle est problématisée, elle se fonde sur la chronologie, car le besoin
de repères spatio-temporels se révèle essentiel aujourd’hui. Elle reste un ciment central de compréhension
du vivre-en-commun.
Ainsi, les besoins pédagogiques vont dégager des pistes considérables
pour une histoire stratifiée ouverte, indispensable partout sur la planète,
rappelant le passé local et nos grands mouvements mondiaux.
Mais peut-on pour cela continuer à survaloriser le texte comme
source (et comme outil pédagogique d’ailleurs) ? C’est impossible à Begram
comme à Mapungubwé. C’est absurde pour la guerre d’Algérie comme pour les Twin
Towers.
Le visuel : source
d’études parmi d’autres et matière d’une histoire générale nécessaire
Lors du colloque-bilan de 2006 que j’avais organisé avec Christian
Delporte Quelle est la place des images
en histoire ?, deux conclusions sont apparues nettement : les
images (ou le visuel pour adopter un terme plus général) sont des sources parmi
d’autres pour les historiens ; de même qu’il existe une histoire de l’art,
ou des histoires des arts, il est légitime et nécessaire de travailler
aujourd’hui sur une histoire général du visuel combinant la production artistique
et non-artistique.
Que le visuel soit une source indispensable, les préhistoriens,
historiens de l’Antiquité (Jean-Pierre Vernant, François Lissarague) ou du
Moyen-Age (Jacques Le Goff, Michel Pastoureau, Jean-Claude Schmitt) et des
périodes classiques (Daniel Roche ou Joël Cornette), l’ont intégré depuis
longtemps, d’autant que pour certaines périodes l’écrit manquait. Il n’en fut
pas de même pour des pionniers comme Michel Vovelle sur la mort ou la
Révolution française, Marc Ferro avec le cinéma, Maurice Agulhon et ses études
sur Marianne. Désormais, les barrières sont franchies. Christian Delporte est
passé du dessin de presse, à la presse et à la télévision. Antoine de Baecque a
étudié les caricatures de la Révolution française tout en développant ses
études sur le cinéma. Il y a longtemps que des historiens d’art comme Laurence
Bertrand Dorléac ou Philippe Dagen ont fait sauter les frontières entre
histoire et histoire de l’art.
Il est donc temps d’affirmer le second point : la nécessité d’une
histoire générale de la production visuelle humaine. Cette nécessité est
d’abord pédagogique. A l’ère d’Internet et des jeux vidéo, il n’est plus
possible de ne donner des repères aux enfants que sur l’art ou les arts. Ils
ont besoin de repères généraux au moment de la production, de la circulation et
de l’accumulation exponentielle des images. Tout se brouille avec la même
actualité sur écran, alors les enseignements doivent intégrer trois
dimensions : des méthodes d’analyse des images ; des repères en histoire
générale du visuel ; des initiations aux techniques et à l’acte créateur.
Nous vivons un basculement de civilisation et de générations. Il faut
promouvoir une prise de conscience complète. L’art, invention européenne à la
Renaissance, est une notion qui a proliféré au XXe siècle en faisant exploser
ses frontières. Frontières temporelles : il a absorbé les périodes
antérieures où s’opérait une « esthétisation de l’utile », selon les
termes de l’anthropologue Jacques Maquet. Frontières spatiales : l’art
européen s’est diffusé sur la planète ; les productions utilitaires
(masques, armes…) d’autres continents ont été présentées comme de
l’ « art », au risque d’accusations de néo-colonialisme ;
désormais, il existe un marché de l’art planétaire avec des artistes de toutes
origines. Frontières techniques : après que Marcel Duchamp ait présenté
des objets utilitaires comme œuvres d’art, la notion d’art s’est ouverte aux
« arts », land art, photographie, cinéma, vidéo…
Ce mouvement englobant dans lequel les frontières entre arts, arts
décoratifs, arts appliqués (quel sens en effet gardent les frontières, quand
« le regardeur fait l’œuvre » et les musées multiplient les
« installations » ?) est aussi un mouvement englobé. Si un
tableau constitue désormais un objet-image premier, unique, il est généralement
perçu grâce à des images secondes à l’ère de « sa reproductibilité
technique » (selon l’expression de Walter Benjamin) : photographie,
film, écran, carte postale, poster…
Pourtant, même avec ces extensions, les images dites artistiques sont
minoritaires par rapport à la production visuelle globale. Voilà pourquoi il
est devenu indispensable pédagogiquement de donner des repères en histoire
générale du visuel. Voilà pourquoi il est urgent d’insérer les études
d‘histoire de l’art ou des arts dans des études plus larges d’histoire du
visuel qui intègrent les spécificités du territoire artistique et la nécessité
aussi d’études très spécialisées et pointues sur ce territoire. Voilà pourquoi,
symboliquement, il serait temps de rebaptiser --en étendant ses missions—l’Institut
national d’histoire de l‘art (dont nous protestions déjà à l’origine, à
quelques historiens d’art, contre la dénomination) pour qu’il donne de l’allant
à l’élargissement des études nécessaires en devenant un Institut international
d’histoire du visuel.
Il faut prendre date. Cela ne sert à rien en effet de ressasser la notion
de « crise », qui est une couverture pour l’immobilisme et la cécité.
Les trois pistes d’avenir rapidement développées ici peuvent permettre de
secouer les conservatismes décalés de la réalité du terrain. Elles permettront alors
de conforter la discipline, de répondre aux nouvelles nécessités pédagogiques
et d’ouvrir à des champs indispensables de recherches. A circuler dans le
monde, je le constate : ce sont là de vraies attentes, partout. Il est
temps de sortir du repli sur soi et de la morosité.
|
| 21 : 02 : 13 |

COLORS : Blue Economy or Black and Green Way of Life ? |
Le magazine WE DEMAIN vient de lancer un manifeste pour "l'économie bleue", inspiré des théories de Gunter Pauli. Il s'agit en fait de réconcilier économie, entreprises avec écologie et éthique. Cela fait longtemps que dans ces colonnes, la notion de "décroissance" est contestée à cause de sa négativité. En revanche, les livres ou films ici présentés et le site des Brésiliens et Canadiens (www.see-socioecolo.com) défendent des économies diversifiées dans un contexte local-global. Là où François Mitterrand a eu raison en France fut de convaincre par la preuve que l'économie étatique et centralisée ne fonctionnait pas. Mais, du coup, nous avons eu droit par effet de balancier aux années Tapie avec une sorte de voyoucratie capitaliste ("plus je m'en mets dans les poches, mieux je me porte"). Ce dévoiement même des théories libérales a abouti à l'immoralité financière actuelle, impossible à maîtriser sans accords globaux au temps des paradis fiscaux et de l'argent caché partout. Cette crise morale est une insulte à 90% des populations. Après la chute du communisme avec l'ouverture du rideau de fer, nous vivons celle du capitalisme avec la multiplication de l'argent virtuel hors économie réelle.
En noir et vert, reconstruisons une conception d'avenir
Face à cela, ayons définitivement conscience de l'échec patent des 2 courants de pensée extrémistes du XXe siècle : le nationalisme autoritaire et xénophobe ; le communisme d'Etat et les gauchismes anti-démocratiques et étatiques. Alors, il serait peut-être temps que les médias intermédiaires --occupés des mêmes "penseurs" depuis 30 ans, qui se sont trompés sur tout en clamant les seules vertus du "marché"-- aillent aux bonnes sources. Pensons à nos jeunes et passons aux préoccupations de l'ère Internet.
Ces sources plongent dans le socialisme mutualiste et coopératif du XIXe siècle allié aux théories émancipatrices libertaires (Reclus, Thoreau) soucieuses de l'environnement. Elles combattent la conversion socialiste à un capitalisme non régulé et les errements anarchistes (le terrorisme et le refus d'organisation sociale). J'y ajouterais immodestement --mais qui le fera sinon ?-- deux de mes apports théoriques essentiels (en dehors des travaux scientifiques pionniers sur images et médias, à découvrir sur www.decryptimages.net) : la théorie de la relativité (qui est une ouverture à différents modes de vie et de pensée, de civilisations, dans une défense de la diversité et de la diversification) et celle du mouvement (pas de société parfaite, figée, la nécessité d'évolution perpétuelle et d'expérimentation). Tout cela s'inscrit dans un rapport des humains avec l'environnement depuis la Préhistoire que j'ai voulu synthétiser avec Une Histoire générale de l'écologie en images.
Voilà donc un courant qui plonge ses racines dans le XIXe siècle (et avant, chez Montaigne ou Rabelais, par exemple) et réapparaît dans l'après 1968 (où l'écologie était absente). Nous, les libertaires écologistes, n'avons jamais renié en effet nos convictions fondatrices. Nous, les noirs et verts (si l'on veut s'en tenir aux couleurs politiques traditionnelles), ne nous sommes jamais convertis au rouge ou au bleu. Le bleu, nous dirait Michel Pastoureau, est la couleur de la droite, de la permanence. Mais notre tolérance (comment être contre l'économie bleue ?) et notre répugnance à l'organisation partisane (avec autant de variantes que d'individus) nous pénalise médiatiquement par une invisibilité totale alors que nous sommes des millions et avons un "corps de pensée" beaucoup plus solide à l'épreuve des faits que nos adversaires, et sur une durée longue.
Voilà pourquoi a été lancée la Coopliberterra (sur see-socioecolo.com) : pour rassembler beaucoup de mouvements différents à travers la planète, qui se disent politiques ou non. Il est temps d'être vu, connu, reconnu dans son cercle. A titre personnel, j'ai passé ma vie à tenter de devenir un penseur complet, un nouvel honnête individu du XXIe siècle. C'est déjà pas mal et c'est probablement le cas aussi de mon libraire-dépositaire. D'accord ou pas d'accord, il faut comprendre la montée de ces types de réflexions : les noirs et verts ont désormais droit à la parole, à la visibilité publique, même s'ils n'aiment pas se montrer.
Le temps du LIEN / LINK
Ce qui déroute les médias intermédiaires, réside dans l'aspect disséminé de nos actions et la diversité de nos pensées. Un moment, un papy oublié (Stéphane Hessel) rappelle la nécessité d'indignation, mais les mouvements sont beaucoup plus larges. Il n'existe pas de parti structuré, ni de "leader" naturel, car nous n'en voulons pas.
Un exemple : Michel Onfray tente de revivifier en France les théories libertaires. Cela ne peut être regardé que comme sympathique, de même que ses théories hédonistes et ses activités autour du goût. Mais parfois ses positions proches de gauchistes étatiques autoritaires ou son défaut de prise en compte des théories écologistes me heurtent. Il faut pourtant désormais oublier cela et rassembler toutes celles et ceux qui vont dans le sens de faire bouger les sociétés vers plus de justice et de durabilité : l'université populaire d'Onfray ou l'économie bleue ou les Colibris (et Rabhi) ou un électron libre comme Daniel Cohn-Bendit (éloquent, Européen sincère, mais peut-être pas toujours suffisamment ouvert sur le monde).
Nous devons fédérer, inventorier, dans la plus grande ouverture possible. C\'est ainsi qu'outre la Coopliberterra, se crée sur www.globalmagazine.info la Coopcultu (Coopérative culturelle, dont l'originalité est de recenser systématiquement toutes les initiatives innovantes, des AMAP aux expos). Tout ce qui vise à changer le lien social. Dans ce cadre, les entreprises adoptant une attitude éthique en interne et avec leurs fournisseurs et clients ou les administrations innovantes (création de café, épicerie, poste, banque, lieu de vie dans les petits villages ; diffusion d'opérations gratuites pour une économie de l'échange non-financier...) ont leur pleine place, comme l'économie de la gratuité ou sociale et solidaire.
La base parle à la base. Elle peut réveiller les sociétés en transformant les consommateurs-spectateurs passifs en spectateurs-acteurs et en consommateurs-acteurs. Le réveil de la démocratie et la mobilisation locale directe sont indispensables. L'économie ne peut en faire l'impasse. Car ce n'est pas en multipliant les multinationales que les territoires vont se réveiller, mais en dynamisant les PME et en rendant plus responsables et efficaces les administrations.
Nous vivons en micro-réseaux. Il faut les lier, les rendre plus visibles, qu'ils prennent conscience de leur force et de leur caractère incontournable. Les grandes structures de l'Etat doivent jouer avec cette base, c'est çà la culture, la reconstruction du vivre ensemble : un localisme ouvert sur le monde. Je l'ai écrit dans Le Local-Global. Changer soi pour changer la planète. Je souhaite le faire au service de tous à la tête de grandes institutions, pour aider à opérer une vraie démocratisation culturelle. Il est temps en effet d'ouvrir les yeux sur le futur : donner des perspectives, c'est associer le peuple ; maintenir l'opacité dans l'effort nécessaire, c'est courir le danger d'une hostilité générale.
Reconstruire un futur, c'est penser le présent, un présent sur lequel chacune et chacun peut peser. En bleu, noir et vert, en espoir en tout cas.
|
| 02 : 02 : 13 |

L'Islande : expérimentations boréales |
Matthias Abhervé surpris par les Islandais en pleine opération "Knowledge is Beautiful". Les signes se répandent sur la planète avec toutes les météos. L'Islande a d'autant plus de sens que ce petit pays isolé s'est sorti avec vaillance et de façon originale de la cameuse crise financière, qui serait plutôt une crise de nos valeurs et, après la crise du communisme d'Etat, celle du capitalisme sans contrôle (dénoncé, par exemple, à travers les positions des "économistes atterrés" ou remis en cause par le "pouvoir latéral" de Jeremy Rifkin). Ils nous envoient ainsi un message local pour notre fonctionnement global.
Cette dimension --comme je l'ai écrit (Le local-global. Changer soi pour changer la planète)-- est devenue fondamentale partout. Elle introduit une nouvelle structure horizontale en réseau, sortant des seuls fonctionnements pyramidaux en place depuis les Néolithiques. Les Egyptiens de l'Antiquité, comme les Mésopotamiens ou les Aztèques, avaient symbolisé la société de leur temps par cette montée au ciel élitiste. Désormais, le symbole de nos réalités serait plutôt ces immensités planes, comme en Islande, qui nous intègrent ou --des artistes le traduiront-ils ?-- un immense filet au-dessus du sol dans lequel nous sommes et qui nous lie aux autres. La solidarité n'est plus une vertu ni un choix, elle est une nécessité. Merci pour ce regard boréal !
Et merci à l'ami Erro !
|
| 20 : 01 : 13 |

Il neige : je pense au Mali |
Un troupeau rentre le soir au Sahara, partie nord de Tombouctou.
Quand j'ai tourné fin 2009 le film "La pauvreté, c'est quoi ?", au titre volontairement provocateur, je m'imaginais peu qu'il deviendrait un témoignage précieux (je devrais d'ailleurs faire un second film avec les centaines d'heures de rushes inutilisées, comme celles du long historique de Tombouctou et la visite de toutes les bibliothèques publiques ou privées). Seuls des Maliennes et des Maliens, célèbres ou non, y parlent. Il nous promène --en interrogeant les stéréotypes sur l'Afrique-- entre Bamako, Ségou, Mopti, le pays Dogon, Tombouctou et le Sahara, jusqu'à l'ouest à Kayes et au fleuve Sénégal près de la frontière mauritanienne, frontière de l'immigration.
Ici, il neige sur la butte Montmartre. Montmartre-sur-Canada. Par ailleurs, j'ai 57 ans depuis hier et suis heureux d'aller vers la soixantaine, accompagné par un tanuki malin et épanoui. Oui, il est temps d'avancer. Glissant sur les flocons, je pense à mes amis maliens, à ce pays des Peuls, des Bambaras, des Dogons, des Bozos ou des Touaregs, que j'ai vu vivre en paix, en harmonie, en complémentarité. Bientôt, l'exposition à succès du parc René Dumont "Le Mali, derrière les images" du Musée du Vivant sera téléchargeable gratuitement en ligne sur le site www.decryptimages.net. Elle a été écrite en croisant les mains dans l'amitié entre Aminata Traoré, Abdoulaye Camara, Marc Dufumier et moi-même. Voilà une seconde façon de mieux connaître ce pays, les enjeux de l'Afrique aujourd'hui et la question des représentations du continent.
|
| 19 : 01 : 13 |

Les étrangetés du mariage |
Comme toujours, dans les débats tranchés et polémiques, il existe toute une frange de population qui se sent extérieure et inécoutée. J'ai beaucoup hésité avant de m'exprimer sur le mariage gay car il faut plus que 3 secondes de slogan pour traiter correctement cette question.
Qu'on le veuille ou non, le fait de s'engager solennellement à vivre en couple ne peut avoir de sens que religieux. A l'heure du record de divorces, cette promesse folle et présomptueuse nécessite une croyance pour pouvoir être tenue. Si ce n'est devant le divin, est-il rationnellement acceptable de pouvoir ainsi se promettre pour des années ? Personnellement, voulant être honnête, je ne l'ai jamais fait et ai pourtant été probablement plus fidèle et plus constant dans mes deux vies de couple successives (avec 2 enfants dans la première et un troisième enfant actuellement) que beaucoup de personnes mariées. Mais ce fut par choix réciproque dans une sorte de contrat renouvelé chaque jour.
Voilà pourquoi je suis fondamentalement hostile au mariage et à tous ses succédanés civils genre PACS : ils me semblent relever d'une malhonnêteté intellectuelle de départ (dont d'ailleurs les divorces faciles et fréquents sont la preuve), sauf à croire en Dieu et à placer cet engagement sous le signe irrévocable du divin, comme on entre au couvent ou au monastère. Au nom de ma laïcité foncière, je respecte d'ailleurs tout à fait cet engagement religieux qui relève de la liberté absolue de conviction individuelle.
Pourquoi les homosexuels veulent-ils alors adopter une coutume civilement hypocrite et religieusement interdite pour eux ? Personnellement, je leur conseillerai de continuer à avoir des vies libres et à éviter de se marier, comme d'ailleurs les hétérosexuels.
Néanmoins, la phase positive de ce combat est la banalisation de l'homosexualité. Même si elle est une réalité minoritaire dans les sociétés, elle est --n'en déplaise aux religieux-- constitutive de cette fameuse "nature" humaine depuis les temps les plus reculés. D'où d'ailleurs des prêtres qui ont de telles pratiques en cachette et des pays où elle est passible de peine de mort mais où des puissants sont homosexuels. Sans compter que chaque être humain a en elle ou en lui des aspects ambivalents.
N'oublions pas alors qu'au-delà de la question marginale du mariage homosexuel, le grand enjeu véritable dans la constitution d'un Pacte planétaire évolutif est la suppression universelle (du moins dans notre univers terrien) de toute répression contre les homosexuels. Nous sommes en effet très loin du compte et vivons dans beaucoup de pays des situations scandaleuses, parfois dramatiques et toujours hypocrites.
Alors que chacun fasse comme elle ou il veut mais moi je continuerai à refuser le mensonge du mariage pour vivre les joies d'une fidélité à ma vie de famille chaque jour renouvelée contre vents et marées de la vie.
|
| 10 : 01 : 13 |

Avec Charlotte, René Dumont disparaît une deuxième fois ! |
Quelle tristesse. Pour qui a connu Charlotte Paquet-Dumont, la veuve de René Dumont, sa disparition est la fin d'une personne exceptionnelle d'intelligence, de modestie et de passion. Tellement vive et attachante.
Admise à l'hôpital dimanche dernier 6 janvier à Windsor au Québec, avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque sévère, elle a subi un accident vasculaire cérébral fulgurant pendant les examens.
J'avais passé une semaine chez elle à classer tous les objets et archives de René Dumont. Elle était venue au Musée du Vivant (www.agroparistech.fr) où je l'avais interviewée. La Fondation Dumont l'avait accueillie pour un hommage à René Dumont.
Surtout, j'ai pu apprécier son enthousiasme, son énergie, son empathie que je n'oublierai jamais. Là voilà devant ma cabane à Montmartre. Je vous embrasse Charlotte.
|
| 21 : 12 : 12 |

I AM YOU, YOU ARE ME |
Use this sign. We want to build a new generous world. Have a look at www.see-socioecolo.com. Use our signs. Liberterra Networks. Justice and sustainability.
Hope is our aim. No gestion, transformation. Art is politics.
Ouvrons la voie de perspectives généreuses pour un futur en commun, plurielles et d'avenir (plurofuturo), soucieuses de justice et de durabilité (www.see-socioecolo.com), de libertés individuelles et collectives sur une planète nécessairement solidaire (Liberterra Networks). Les initiatives se multiplient partout. Faisons savoir. Echangeons en réseaux. Multiplions les actions de générosité.
2013, année de la générosité !
|
|